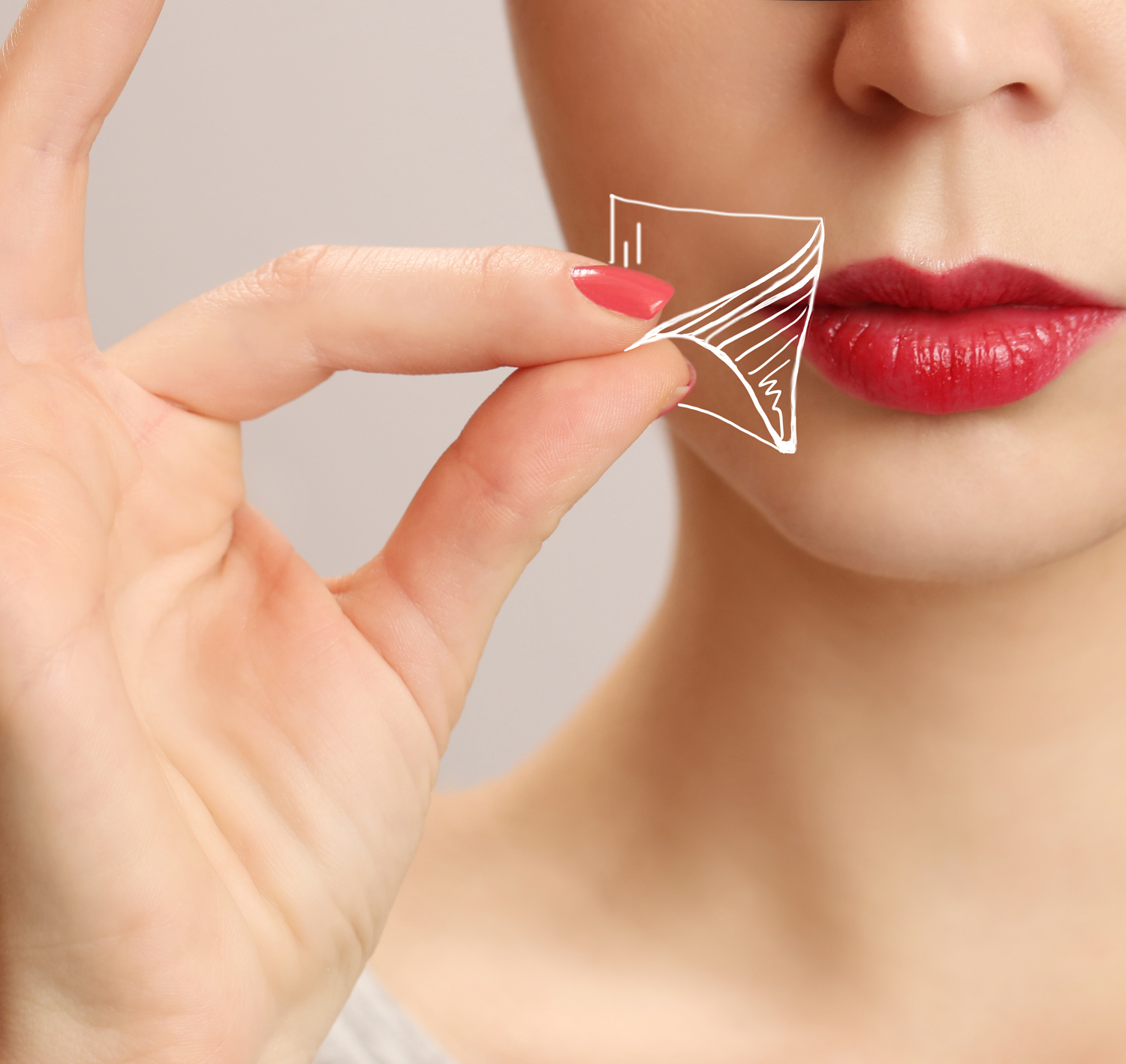J’enseigne depuis 13 ans. Je n’ai pas toujours travaillé pour l’éducation nationale. J’ai un parcours atypique, et c’est tant mieux car j’aurais sûrement enseigné moins longtemps si j’avais eu le chemin classique de l’étudiant ayant eu son concours à 24 ans au sortir du master ; tant cette institution m’aurait rapidement dégoûté du métier.
J’ai commencé à enseigner en Amérique latine où j’ai fait la majeure partie de mes études supérieures jusqu’en doctorat. J’ai enseigné à l’Alliance française, à l’université (en lettres modernes), dans différents lycées français et ensuite en France à partir de 2014 dans une école hors contrat dédiée à des élèves handicapés dans leur apprentissage scolaire et aussi dans un lycée privé sous contrat.
J’adorais mon métier. J’ai toujours été bien noté par mes supérieurs, par la façon dont je préparais mes cours, dont je construisais mes cours, dont je transmettais les savoirs et j’ai toujours eu de bons rapports avec mes classes où l’ambiance était propice au travail.
En juin 2018, j’obtins le concours dès la première tentative pour devenir professeur d’espagnol dans l’éducation nationale après plusieurs mois de préparation en plus de mon travail de professeur. Je donnais cours le matin et je travaillais en bibliothèque l’après-midi (dissertation, thème, version, lecture de livres recommandés, fiches, préparation des oraux, etc.). Je découvris aussi que mon nom était en plus très bien classé ce qui était pour moi la récompense d’un travail personnel intense nécessaire à la réussite. La joie sera de courte durée, le temps d’un été.
En septembre, j’intégrai l’ESPE (ancêtre de l’IUFM et qui a encore changé d’acronyme récemment) école censée former les nouveaux professeurs et rattachée à une université. Parallèlement, j’étais en stage huit heures par semaine dans un lycée. La musique douce commençait, on me dit que j’étais dans « un lycée calme d’une banlieue privilégiée », refrain que j’entendrais quatre ans durant à chaque changement d’établissement pour un résultat toujours décevant et similaire.
Rapidement, je m’aperçois que je n’apprends rien à l’ESPE, que l’on nous traite en nous infantilisant, que leurs théories sont fumeuses, que leurs conseils sont inapplicables, que les formatrices (je parle au féminin car elles étaient toutes des femmes) n’ont plus aucun contact avec le réel, que l’on nous culpabilise et même que l’on nous dégoûte du métier.
Je m’aperçois aussi que certains des collègues n’ont pas un bon niveau en espagnol (beaucoup de fautes de langue, de grammaire et un accent français très prononcé), une absence profonde de culture et un désintérêt pour celle-ci mais, en revanche, une préoccupation importante pour des questions du bien-être des élèves, d’écologie, d’écriture inclusive, d’inclusion, de vivre ensemble ; en somme, des questions hors sujet comme je le pensais naïvement.
Les « savoirs savants », comme on nous le répétait avec mépris, c’est-à-dire les savoirs que l’on doit transmettre (mille fois supérieurs à ceux de l’élève comme je l’appris autrefois de mes professeurs) sont très mal vus ; d’ailleurs, on nous le dit rapidement : « Vous êtes là pour éduquer, vous n’avez rien à transmettre ».
Il nous est aussi interdit de faire de la grammaire, de la conjugaison, de traduire des mots et de faire apprendre du vocabulaire en classe : « L’élève doit deviner par lui-même » ; « Le professeur doit mimer sans le dire ». C’est ainsi que je verrai ma tutrice – très croyante de ce système – lorsque j’irai dans sa classe en observation, mimer tout le contenu de son cours, prononcer seulement la première syllabe d’un mot en attendant miraculeusement la suite, essayer de faire deviner la conjugaison d’un verbe, etc.
Outre le ridicule et le pathétique de la situation, les élèves ne devinaient rien du tout et n’apprenaient au final pas grand chose. « Ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre » écrivait Spinoza.
Je m’aperçois rapidement que le niveau général est catastrophique : les élèves ne savent plus reconnaître le mode subjonctif, ignore ce qu’est le plus-que-parfait ou le passé simple, ne savent pas trouver un sujet dans une phrase ni ne savent définir ce qu’est un verbe et ce, dans leur propre langue, le français.
Je me rends compte aussi qu’un auteur aussi populaire qu’Alexandre Dumas qui berça mon enfance et mon adolescence demeure inconnu pour ces élèves d’un « établissement calme et privilégié ».
Du point de vue de la discipline, les cours sont de véritables forums de discussion, les portables pourtant interdits sont consultés ouvertement par les élèves, les retards sont acceptés, la moindre fantaisie de l’élève est prise en compte (par exemple, il me sera interdit d’interroger certains élèves car ils ont été « traumatisés » par le professeur de l’année d’avant. Traumatisé comment ? Je pousse le vice jusqu’à voir l’infirmière « bienveillante » qui me dit qu’elle ne peut rien dire à cause du « secret médical »).
Je n’interroge donc pas ces quelques élèves qui ne sont dans tous les cas pas traumatisés pour discuter et rire pendant mes cours… Je note aussi un comportement agressif, insolent de beaucoup d’élèves qui ne supportent aucune critique, sans compter les tenues vulgaires et outrancières de certaines jeunes filles gavées de télé réalité qui n’étaient visiblement pas au lycée pour travailler.
Je me rends compte des pressions exercées sur les professeurs pour modifier une note jugée insuffisante soit par l’élève, soit par ses parents, soit par les deux et même parfois par le professeur principal qui n’hésite pas à faire pression sur son collègue pour augmenter ladite note.
Je constate à mon insu les changements d’appréciation sur les bulletins qui ne peuvent être que « positives » ou « bienveillantes » : une main « bienveillante » et inconnue a donc changé mes remarques pour mon plus grand bien et celui des élèves.
Le mot « bienveillant » nous est répété plusieurs fois par jour, il hante les couloirs, la salle des professeurs et bien sûr la bouche des formatrices de l’ESPE. Ce mot répété à l’envi que mon cerveau ne perçoit plus, me fait horreur.
La bienveillance, concept à la base chrétien, est en réalité, dans le catalogue lexical de lâcheté de l’éducation nationale, de la complaisance : dire oui à tout, se coucher, s’aplatir et même disparaître devant le client roi : l’élève et ses parents.
Beaucoup de collègues stagiaires, dépassés par leurs classes criaient à l’aide chaque mercredi après-midi entre les murs de l’ESPE. Réponses des formatrices : « bienveillance », « mettre un élève à la porte est l’échec du professeur », « on ne doit pas punir un élève mais parler pour désamorcer le problème », « il faut encourager l’élève, lui dire qu’il est capable » ; « posez-vous la question si votre cours a été suffisamment préparé car si l’élève parle c’est que votre cours l’ennuie » ; fadaises que l’on n’appelait pas encore « pas de vague ».
Beaucoup, dont moi-même, iront d’office pendant deux jours au stage « Ma classe apaisée » au rectorat afin d’écouter les grosses ficelles psychotechniques bidons de deux formatrices bien idéologisées afin de ne surtout pas appliquer la loi à l’élève car c’est le professeur qui doit se remettre en question.
Pendant ce stage, on nous fait jouer l’élève et le professeur en déplaçant tables et chaises de la salle. Ainsi, le professeur doit être à l’écoute, ramasser la copie jetée par terre par l’élève et la commenter avec lui. Nous sommes estomaqués, pas un collègue n’est d’accord pour s’humilier à ce point-là. Après les sketches, les simulacres tous plus pathétiques les uns que les autres, il est question des discriminations vécues par les élèves, du racisme, de l’homophobie… la plupart des collègues n’écoutent plus rien et font autre chose sur leurs ordinateurs (liste de courses, dessins, préparation de la prochaine séquence de cours, etc.). Deux jours de perdu.
Comme les problèmes ne sont toujours pas résolus et que pèse sur nous la menace sans cesse répétée de la perte de notre concours et de notre renvoi, on nous proposa par la suite des « visites conseils » pour nous apprendre en réalité à nous aplatir davantage. Véritable visite inquisitoriale, le tuteur est convoqué avec un formateur (en réalité collègue d’un autre établissement) afin d’observer le cours du professeur stagiaire. Je n’aurai le droit qu’à une seule visite, heureusement.
Professionnel, sérieux, je prépare à fond mon cours pour le jour de la visite mais je comprends très vite (et j’en aurai la confirmation lors de l’entretien qui suivit) que le contenu de mon cours n’intéressait pas le collègue observateur. Son attention portait sur comment je tenais ma classe, comment les élèves réagissaient et s’ils bavardaient beaucoup. Mes élèves, soucieux de bien faire, s’étaient vraiment très bien comportés pendant le cours et il n’y avait rien à dire sur leur attitude, les critiques devant s’orienter plutôt vers un niveau déplorable et médiocre pour une classe de terminale censée avoir fait de l’espagnol depuis 6 ans et incapable de faire une phrase simple correctement ce qui, évidemment, aurait remis en cause le système qui les avait menés jusque-là.
Le collègue qui jouait à l’inspecteur sans en avoir ni le statut ni le salaire m’accusa le plus sérieusement du monde d’avoir dressé les élèves comme des animaux, de les avoir manipulés pour qu’ils se tiennent correctement. En fait, je me rendis compte que j’étais dans une impasse et que je ne pouvais me défendre face à un système sorti tout droit du Procès de Kafka : si les élèves étaient agités c’est parce que je manquais d’autorité et si les élèves étaient calmes et travaillaient c’est parce que j’étais un dictateur. J’étais donc dans une impasse et argumenter aurait joué en ma défaveur.
M’étant syndiqué pour la première fois de mon existence, je rapportai la scène à mon syndicat par téléphone qui me fit comprendre qu’il ne pouvait rien faire. Je devais surtout m’écraser, montrer patte blanche car l’inspectrice était redoutable sur ce secteur et avait déjà licencié plusieurs professeurs stagiaires ou leur avait fait redoubler leur année. Je devais donc faire un double effort face à l’impuissance des syndicats : me serrer la ceinture d’un point de vue financier car la première année le salaire est misérable et aussi m’écraser si je ne voulais pas perdre mon concours si durement acquis.
L’autorité pour l’éducation nationale est un mot grossier qui est volontairement confondu avec autoritarisme. La peur, la lâcheté de l’administration font que non seulement le professeur est abandonné à son propre sort en cas de conflit avec un élève ou avec un parent mais en plus, il sera sacrifié afin de ne pas faire de vague et de ne pas entacher l’institution. En réalité, l’éducation nationale et l’état ont peur.
L’année de mon stage, un instituteur de cinquante-sept ans et père de famille, aujourd’hui oublié, s’est pendu à un arbre dans une forêt à quelques pas de son domicile après qu’une mère a porté plainte contre lui pour avoir fait une griffure dans le dos de son enfant de six ans. L’administration l’avait tout de suite accusé donnant raison à la mère et le mit en retrait de l’école sans entendre sa version des faits. Un collègue avait tenté en vain d’aborder ce sujet à l’ESPE mais « son insolence » fut balayée d’un revers de main par la formatrice qui avait visiblement des pratiques et des conseils plus importants à nous transmettre.
À un autre moment de l’année, c’est un collègue d’espagnol de l’ESPE d’une classe voisine à la nôtre que l’on retrouva pendu chez lui. Les formatrices ne voulurent pas non plus faire de commentaire sur cet « incident » comme elles l’appelèrent.
Le lexique orwellien de l’éducation nationale mériterait à lui seul une thèse de doctorat en linguistique ou en sociologie tant il est aberrant. Nous ne saurons jamais pourquoi ce collègue d’origine espagnole, lauréat du CAPES 2018 décida de mettre fin à ses jours. Une collègue organisera un petit rassemblement devant les portes de l’ESPE avec sa photo et des bougies. L’histoire s’est arrêtée là.
La sanction est un autre mot tabou dans l’éducation nationale. En réalité, elle n’est jamais appliquée. Dans le premier lycée « calme et privilégié » que j’ai traversé fut affiché en milieu d’année dans la salle des professeurs la liste des élèves renvoyés durant un à plusieurs jours, j’y ai vu une cinquantaine de noms différents dont certains élèves de mes classes. La direction a pour habitude de se débarrasser facilement de l’élève en l’envoyant chez lui avec du travail que, bien sûr, chaque professeur doit fournir en plus de ses cours. Travail qui n’est jamais fait ou si peu. L’élève (selon les témoignages des élèves que j’ai interrogés) reste chez lui à regarder des séries sur Netflix, à fumer du cannabis ou à traîner dehors avec ses copains.
Le renvoi de l’établissement, symbole de honte et presque d’infamie à « mon époque », car il supposait le très craint conseil de discipline qui mettait l’étiquette d’infréquentable sur le front de l’élève, est devenu aujourd’hui tellement banal qu’il est considéré comme des jours de vacances supplémentaires par les élèves. D’ailleurs, j’ai vu des élèves renvoyés le jeudi et le vendredi par exemple leur offrant ainsi un beau week-end de quatre jours et même parfois les mêmes jours en fin de semaine à la veille des vacances scolaires.
Les heures de colle, hantises d’autrefois pour le cancre ne sont jamais faites ou alors données à la carte car le parent les conteste en raison des heures de sport, de théâtre ou autres activités que son enfant ne peut manquer. Bien souvent, le parent disconvient de la punition et celle-ci est transformée en lettre d’excuses (lettre pleine de fautes d’orthographe et à la syntaxe inexistante que l’élève remettra à son professeur sans honte aucune dans une belle enveloppe).
La deuxième possibilité est qu’en réalité la punition est supprimée par le professeur qui sait qu’il ne sera pas soutenu et ainsi évite les problèmes.
Les élèves exclus du cours sont ramenés au professeur par les CPE – toujours acquises à la cause de la bienveillance, du dialogue nunuche et grandes copines des élèves – qui doit les accepter de nouveau car « il n’y a pas de surveillant disponible » ou plus cyniquement parce qu’ « on ne peut pas exclure un élève comme ça, ça ne se fait pas ».
Enfin, le rapport écrit qui met d’entrée la parole du professeur en doute et dont je subirais comme tout bon professeur honnête, le sinistre retour de bâton lorsque par exemple – et encore récemment – je rapportai le comportement agressif d’un élève qui ne voulait pas faire un examen m’accusant de ne pas avoir prévenu les élèves suffisamment en avance selon le règlement (lequel ?), entraînant par « solidarité » une bonne partie du reste de la classe dans sa contestation rebelle. Pendant que l’élève en question au comportement totalement déplacé parade dans les couloirs et vaque tranquillement à ses occupations, le prof écrit un rapport qu’il doit d’abord remettre aux surveillants, qui transmettront au CPE, qui transmettront enfin au proviseur qui en soupirera d’excès sûrement d’avance.
Le lendemain ou le surlendemain, le professeur traumatisé est convoqué, il doit réexpliquer toute la scène, rendre des comptes, réécrire son rapport (« Du factuel Monsieur ! Vous ne pouvez pas porter un jugement sur l’élève, on peut se retourner contre vous judiciairement. Supprimez tous les adjectifs et restez factuel ») ; puis, l’élève est convoqué, donne sa version des faits (toujours différente) ; puis, vient la confrontation avec le professeur, l’élève et les parents (quand il y en a deux), confrontation pendant laquelle le professeur doit faire allégeance se rendant compte que le proviseur ne le défendra pas et que le parent est bien souvent le meilleur copain de l’enfant lui donnant raison ou l’excusant.
Il y a rarement sanction car comme me l’ont répété deux proviseurs entre cette année et l’année dernière : « Si je sanctionne l’élève c’est toute la classe qui va se retourner contre vous ». Le professeur en sort humilié, cassé, brisé car en plus de la défaite de son autorité, de sa crédibilité, il a souvent dû écouter les reproches faits par l’élève et appuyés par le parent immature. C’est l’inversion autorisée et normalisée des valeurs.
À la fin, le professeur doit reprendre l’élève en classe et en plus être généreux sur la notation du contrôle qui posa problème et qu’il est quand même parvenu à faire car « les élèves ne l’ont pas fait dans de bonnes conditions ». Le professeur anonyme décrit ici c’est moi, mais aussi la plupart de mes collègues qui pourraient écrire la même chose dans n’importe quel recoin de France car les consignes viennent du ministère.
Quand il y a sanction (un renvoi éventuel, voir plus haut) on prendra soin de ne pas l’indiquer dans le dossier de l’élève (là encore sur pression du parent) afin de ne pas gêner sa future orientation et son avenir professionnel lors de l’inscription à Parcoursup. Quand « l’incident » se passe en collège, la chose est encore plus simple puisque la sanction est retirée d’office du dossier une fois l’élève arrivé à la fin de la classe de troisième.
La décapitation en octobre 2020 de notre collègue Samuel Paty à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, lui aussi abandonné par sa direction – comme le révéla le journaliste et écrivain David Di Notta dans son livre – ne changea rien au sort des autres professeurs pendant les jours et les mois qui suivirent.
L’administration continue aujourd’hui encore de se laver les mains du sort du professeur et n’hésitera pas à rappeler à celui-ci son manque d’autorité en cas de problème dans sa classe avec ses élèves, le menaçant d’un stage bidon à l’autre bout de l’académie, d’appeler l’inspecteur si la situation perdure, et ne se gênant surement pas pour faire en douce un rapport sur lui au rectorat à classer dans son dossier, pour plus tard, lorsqu’il demandera par exemple une mutation.
L’actualité violente de ce mois en est encore la preuve dans « un établissement du 77 calme et serein ». Mon syndicat m’a d’ailleurs déconseillé depuis d’aller voir le proviseur en cas de problème car celui-ci pouvait être susceptible de m’enregistrer à mon insu avec son portable tout en orientant la conversation comme d’autres proviseurs le firent dans d’autres établissements. J’ai l’impression en relatant ces mots de travailler pour une secte ou une mafia ! Je n’exagère rien !
Je fus donc validé en mai 2018 et quittai définitivement l’ESPE.
Certains de mes collègues stagiaires ont redoublé leur année, d’autres furent licenciés. Je ne les ai jamais revus. J’appris qu’une collègue brillante que j’aimais beaucoup et arrivée première à l’agrégation d’espagnol donna sa démission et partit en Amérique latine. Elle comprit rapidement le système et mit les voiles vers d’autres horizons.
Je suis actuellement TZR (titulaire sur zone de remplacement) ayant traversé plusieurs lycées en 4 ans et je peux témoigner qu’il n’y a pas d’ « établissement tranquille et calme » comme beaucoup le proclament hypocritement ou aveuglément. Il est bon de rappeler aux bisounours que Conflans-Sainte-Honorine est une ville charmante et cossue, que le collège du Bois d’Aulne où Samuel Paty fut décapité est calme et n’est pas classé en catégorie REP/REP+ par le rectorat.
Tous les élèves savent très bien (même si évidemment tous ne se comportent pas de cette façon) qu’ils ne craignent rien et que leurs moindres caprices seront écoutés. Toutes les directions fonctionnent à partir des mêmes directives du ministère.
Ainsi, même si le collège ou le lycée est « calme » cela n’est qu’un vernis car derrière cela il y a une violence des échanges dans un milieu tempéré où le professeur sera sacrifié à la fin au sens figuré comme parfois malheureusement au sens propre sur l’autel de la « bienveillance ».
Je me dis aujourd’hui que j’aurais dû dès le premier jour, sachant que « je n’étais pas là pour instruire mais pour éduquer », prendre mon sac et partir. Ces gens m’ont dégoûté de mon métier.
Ma matière comme toutes les autres est devenue une simple activité qui occupe mais ne transmet plus rien. Le système n’est qu’une mascarade, un cache misère où les élèves doivent être occupés, gardés, où tout le monde est tiré vers le bas avec une absence de sélection et un diplôme depuis longtemps démonétisé .
Les élèves ne sont plus que des fantômes qui hantent des statistiques pour ne pas traîner dehors. Les établissements ne sont que des garderies avec des professeurs transformés en animateurs ce qui contribuent à leur mépris et à leur précarisation chaque année plus grande.
Non seulement les places au concours de recrutement des professeurs diminuent drastiquement d’année en année, mais on peut aussi de ce fait s’interroger sur la volonté d’avoir des professeurs compétents : en 2019, l’année du COVID, les candidats au CAPES d’espagnol ont été recrutés à l’écrit lors des premières épreuves et n’ont pas passé l’oral. Outre l’injustice par rapport à leurs collègues qui ont toujours passé les écrits et les oraux, j’ai pu voir dans mon lycée une collègue stagiaire issue de cette promotion – stagiaire qui ne fut ni mon amie ni mon ennemie – incapable de suivre une conversation courante et simple en espagnol.
Dans un avenir proche, la France, l’état et l’institution vont payer très cher l’ignorance fabriquée auprès de ces élèves qui ne savent plus parler, lire, écrire, n’ont pas appris à réfléchir et se transformeront pour un certain nombre, dans la suite logique des choses, en barbares.
— Lycée, 4 ans d’ancienneté